| AVANT TOUTES CHOSES... Le son
|
|
GENERALITES
SUR LE SON
La
hauteur d'un son, qui permet au musicien de connaître la note , do, ré
ou fa est déterminée par la vitesse de vibration des particules
d'air. La hauteur correspond à la position d'un son sur l'échelle
des graves et des aigus. Le physicien préfère parler de fréquence,
qu'il mesure en Hertz. Il s'agit du nombre de vibrations par seconde, par unité
de temps (f=1/t en Hz). Plus la fréquence est élevée, plus
la longueur d'onde est petite. La fréquence d'un son est de 1 Hertz si
les particules d'air effectuent une oscillation par seconde. L'amplitude d'un son correspond à la variation de pression maximale de l'air engendrée par les oscillations, et donc au volume sonore. La dynamique permet de mesurer l'écart entre le volume maximal d'un son et le bruit de fond. Les messages sonores (parole ou musique) ont une variation d'amplitude entre les plus fortes et les plus basses modulations. Ce rapport entre les piani et les forte, s'appelle la dynamique et s'exprime en décibels (dB). En fait il est le rapport entre le niveau maximal, à la limite de la distorsion, et le niveau minimal acceptable, à la limite du niveau de bruit de fond, d'une modulation. Par exemple, pour un compact disque on parle de 90 dB de dynamique utile et en télévision de 25 dB (varie de + ou - 9 dB entre les chaînes). Le timbre est un paramètre beaucoup plus subjectif : il s'agit de ce qui différencie deux sons de même hauteur et de même amplitude. C'est une notion qualitative, qui fera dire, par exemple, qu'un son est brillant, profond. |
|
PRISE DE SON STEREOPHONIQUE | |
|
1-
Prise de son stéréo dite "AB"
On
utilise deux microphones cardoïdes ou bien deux micros omni-directionnels espacés
de 90 cm à 3 m. On leur attribue sur la console les voies droite et gauche. La
distance entre les deux dépend de la source. Par exemple, si on sépare les micros
de 3 m pour capter une guitare, cette dernière apparaîtra au centre dans l'espace
stéréo. Mais la distance assez élevée entre les micros peut générer des problèmes
de phase si la source sonore est décalée. Le son va arriver plus vite vers le
micro le plus proche. Si votre console est positionnée en mono et que votre son
s'accentue ou bien s'atténue, c'est que vous avez un problème de phase |
|
| 2-
Prise de son "X-Y"
La
technique du X-Y utilise deux micros cardoïdes identiques. Les caspules sont placées
en coïncidence ou en semi-coïncidence (distants de 30 cm) et formant un angle
de 90 à 135 degrés suivant la source sonore. La paire de micros fait face à la
source sonore et la console de mixage réglée en voies droite et gauche. La faible
distance entre les capsules fait que le son arrive vers celles-ci pratiquement
en même temps, réduisant (semi-coïncident) ou éliminant (coïncident) les effets
de phase. |
|
| 3-
Prise de son dit "ORTF"
On
utilise deux micros cardoïdes dont les capsules sont espacées de 17 cm (semi-coïncident)
et dont l'angle formé fait jusqu'à 110 degrés. C'est la méthode employée par les
techniciens de la radio/télévision française. |
|
| 4-
Prise de son dite "NOS"
On
utilise deux micros cardoïdes dont les capsules sont espacées de 30 cm et dont
l'angle formé fait jusqu'à 90 degrés. |
|
| 5-
Prise de son stéréosonic
On
utilise deux micros bi-directionnels dont les capsules sont coïncidentes et dont
l'angle formé fait jusqu'à 90 degrés. |
|
| 6-
Prise de son MS (Mid-Side)
C'est
un micro stéréo composé d'une capsule bidirectionnelle et d'une capsule cardoïde
en coïncidence. Le cardoïde fait face à la source sonore tandis que le bidirectionnel
prend l'axe droite-gauche. La combinaison des deux donne une image stéréo. Cette
technique est utilisée en radio, télévision et en cinéma. |
|
|
AKG
C 426 B
 Micro
stéréo avec un angle stéréo réglable entre
0 et 270 degrés par pivotement de la tête,cela
facilite les changement entre les techniques stéréo M/S et X/Y.Deux
LED sont montées sur chaque capsule et fournissent ainsi une vérification
visuelle et rapide de l'angle |
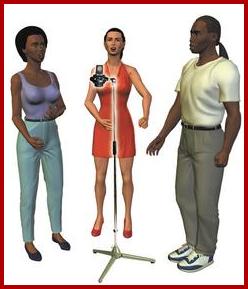 |
A SUIVRE...